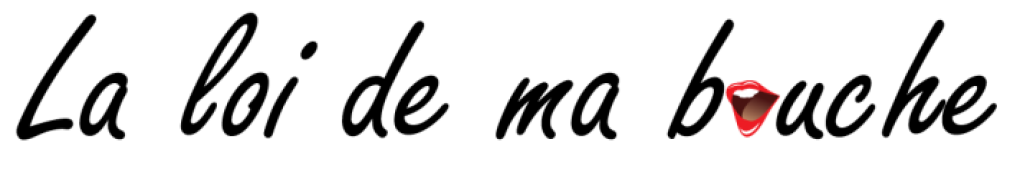Depuis minuit, ce lundi, la République d’Haïti n’a aucun élu. Le dernier tiers du Sénat s’en va, comme il a existé, dans l’indifférence général. Hier, au cours de la journée, le « Président du Sénat », a monopolisé un temps l’attention du pays après que la nouvelle d’une attaque contre sa personne se soit vite répandue sur les réseaux sociaux. Dûment sanctionné par les États-Unis et le Canada pour trafic de drogues, collaboration avec des gangs des réseaux criminels et soutien opérationnel et financier à des gangs armés, le désormais ex-Sénateur Lambert se serait lui-même rendu à la Direction (DCPJ) pour conter sa mésaventure. Alors qu’il se rendait au Parlement Haïtien, des bandits armés s’en seraient pris à lui et à sa sécurité personnelle, au niveau de la Saline. Les premières nouvelles le donnaient pour grièvement blessé, heureusement pour lui, il ne s’en serait sorti qu’avec un éclat de vert sous l’œil gauche – une blessure dont la photo a été partagée via les réseaux sociaux.

Sur la photo, le fameux « animal politique » regarde l’objectif de la caméra d’un seul œil. L’autre est sous des toiles de gaz vaguement roses; un peu comme lui l’a été à l’ère du PHTK. Le regard est neutre et le visage serein. L’on pourrait être tenté de penser qu’il réfléchit à son bilan de Président (contesté) du Sénat: de sa tentative avortée de s’ériger en remplaçant du Président-martyr aux sanctions internationales pour pratiques criminelles. Son visage ne trahit rien toutefois. Peut-être qu’il se contente de regarder l’objectif pour prendre le selfie, partager la photo et passer à autre chose.
L’ancien Sénateur Joseph Lambert est difficilement le plus prédictible de nos politiciens ou, mieux, dans sa classe de nomades politiques, peut-être est-il le plus prédictible de tous. Sénateur Lavalas (2006, 2009) puis PHTK (2017), il passe aisément de l’extrême gauche à l’extrême droite et à tout ce qui peut se trouver entre les deux. Pendant longtemps, l’ancien conseiller (INITE) du Président Michel Martelly (PHTK), a su naviguer dans les eaux troubles de la politique haïtienne, esquivant des accusations d’actes criminels depuis au moins 1999. D’une certaine manière, il s’agit là d’un talent rare.
Aujourd’hui, le voici sans pouvoir, sans visa (américain), et blessé suite à une attaque de bandits armés qu’il est accusé de soutenir ; ce qui n’est pas peu troublant.
Plus troublante encore est la situation à laquelle se trouve confrontée Haïti, en ce lundi matin. Une situation imprédictible d’installation d’une forme d’autocratie proconsulaire soutenue par une communauté internationale qui, après avoir longtemps joué aux savants fous semble en contempler les résultats avec une fascination détachée. Alors que la justification et la légitimité du pouvoir d’Ariel Henry se résument au soutien de cette communauté telle qu’incarnée par le Core Group, celle-ci se fait de plus en plus effacée dans la crise. Même la question des élections, qui semblait prendre de l’importance à la fin de 2022, semble à nouveau disparaitre de l’agenda pour 2023. L’heure est à la crise sécuritaire, l’assistance humanitaire et un élusif accord politique haïtien qui se fait attendre depuis presque quatre ans, soit l’équivalent d’une législature.
En Haïti, les échéances électorales n’existent guère. En 2019, les élections locales et législatives n’ont pas eu lieu. En 2021, les élections présidentielles, non plus. Les élections générales de 2023 ne mobilisent guère. Ailleurs, pour réussir ce genre d’exploit, l’on s’attèle à modifier la Constitution. En Afrique francophone, ce « tripatouillage constitutionnel » s’est spécialisé dans la production des résultats électoraux souhaités par les dirigeants. En Haïti, c’est plus simple, il suffit de ne plus en parler. Fini le temps où la transition passait par le viol collectif d’une Constitution jamais respectée. Désormais, la force d’inertie prévaut. Ariel Henry a été déposé là, il est là, il reste.
Certes, cette situation sui generis continue de réduire à néant le contrôle étatique du territoire national et le monopole wébérien de la violence de l’État, alors que les gangs contrôlent de plus en plus de territoires. D’aucuns postulent que, avec la fin des mandats de parlementaires réputés impliqués dans la mainmise des gangs sur nos vies, des protections vont tomber et avec elles les moyens d’action des bandits armés. D’autres tablent sur un effet domino des sanctions internationales prises à la fin de l’année 2022 contre des chefs de gang, des politiciens et des hommes d’affaires. La réalité est que, dans l’état actuel des choses, tout dépend de ce que prévoit le Dr Ariel Henry, chef de facto de l’État haïtien, et de ceux à qui l’ont placé où il est, suite à un coup d’État par consensus dont la suite semble échapper à ses promoteurs.
L’avenir qu’il nous réserve est vaguement esquissé dans un nouvel accord de « consensus national » qui n’est ni national ni consensuel. Cet accord du 21 décembre 2022 – qui s’inscrit dans le prolongement d’un précédent accord du 11 septembre 2021 – prévoit un Haut Conseil de la Transition (HCT) chargé d’organiser les élections de 2023. En début d’année, pince-sans-rire, le secrétaire américain adjoint aux affaires de l’hémisphère occidental, Brian A. Nichols, a invité à élargir l’accord national consensuel vers un consensus plus large et une plus grande flexibilité de leaders (politiques et économiques) que son pays ajoute pourtant petit à petit sur sa liste de sanctions.
Le tweet est travaillé, calibré, pour dire tout et son contraire. Chaque camp pourra en tirer les conclusions qu’il voudra sans trop s’éloigner de la vérité de la situation: nous sommes livrés à nous-mêmes.
Voilà des années que nous le sommes et peut-être fallait-il toutes ces années pour nous le comprenions mais il est temps désormais de faire face. Personne ne viendra à notre secours, c’est à nous de sauver Haïti. Ariel Henry n’a aucune redevabilité envers nous. L’État haïtien nous échappe. En ce début d’année 2023, il est plus que jamais nécessaire de se rappeler que c’est aux citoyen.ne.s haïtien.ne.s de s’organiser pour reprendre leur destinée ne main. Les politiques, chefs de gang, oligarques qui nous ont mené à cette situation ne vont pas se lever un matin, faire une crise de conscience, et se mettre à résoudre les problèmes qu’ils ont créé. Peut-être aurons-nous droit, en fin de mandat, à un selfie serein, mais sans plus. Seule une mobilisation citoyenne organisée peut faire contrepoids à la situation actuelle et faire avancer les choses. Sinon, l’ère d’Ariel Rex ne fait que commencer et elle s’annonce inquiétante.