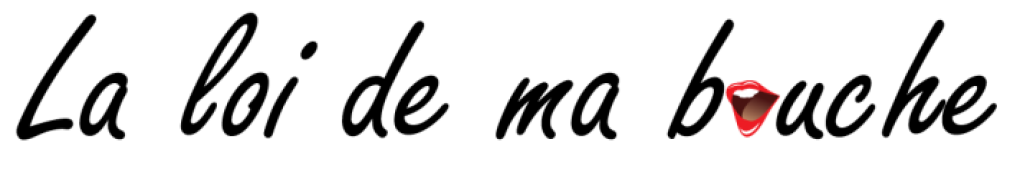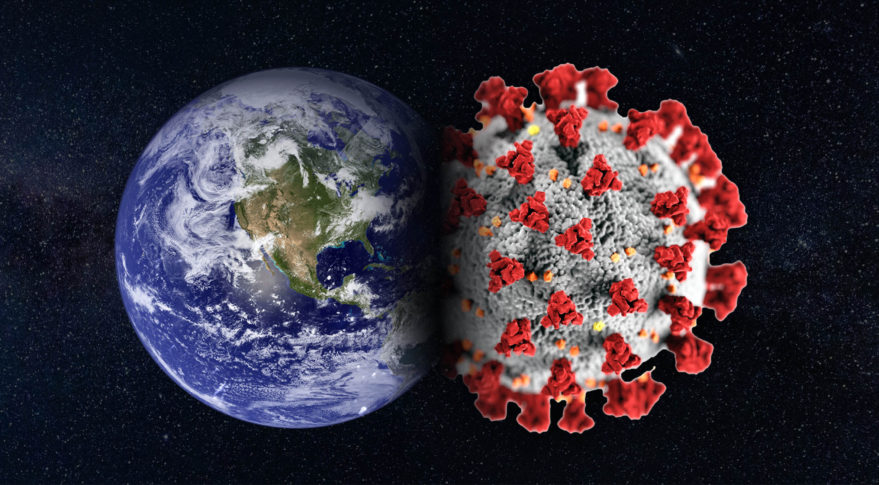Les temps sont durs. En l’espace de quelques mois, la COVID-19 est devenue une pandémie qui a profondément dérangé notre confort dans le Nord et désagréablement rappelé les inégalités sociales et économiques qui sévissent au Nord comme au Sud. Ce qui arrive est extrêmement préoccupant, il n’y a aucune cause, non, aucune, qui justifierait qu’on y voie quelque chose de positif. Des gens meurent. Des gens tombent malades. Des gens sont désorientés. Alors qu’on ne s’est peut-être jamais autant inquiétés pour notre santé physique (tout au moins, cette génération), notre santé mentale est plus exposée que jamais. L’économie est en veille. La machine s’est arrêtée, ou presque. On le pensait impossible. On a toujours clamé que ce n’était pas « réaliste ». Pourtant, c’est arrivé. Plusieurs clament que la planète avait besoin d’un « break ». Je ne sais pas si la planète a des « besoins ». Ce qu’on sait c’est qu’elle a des limites, dites fonctionnelles. Et le dépassement de ces limites nous fait encourir des risques énormes, jusqu’à ceux qui menacent notre survie même en tant qu’espèce. Après tout, nous sommes une espèce relativement jeune dans l’histoire de l’évolution : il ne faudrait pas qu’on se prenne la tête. Tôt ou tard, au rythme où nous allions, nous aurions de toute façon connu une crise écologique globale d’ampleur comparable à la COVID-19, sinon plus grave, d’autant qu’elle s’installerait dans la durée.
Si avec la COVID-19, on sait relativement bien à quoi s’attendre, l’inconnu et les incertitudes liés aux impacts négatifs possibles des changements climatiques et de la perturbation de l’ensemble des équilibres naturels semblent encore plus grands. En effet, on a affaire à des « systèmes socio-écologiques » extrêmement complexes en interaction, et la violation des limites naturelles peut très vite déboucher sur des problèmes vicieux (« wicked problems ») dont l’issue est incertaine. En revanche, si on connait encore mal de quoi sera fait l’avenir de la planète (malgré l’existence de scénarios de plus en plus sophistiqués), la situation actuelle est assez bien connue et des consensus scientifiques existent sur plusieurs points.
Les problèmes environnementaux les plus urgents à l’échelle globale touchent la biosphère, l’hydrosphère et, bien sûr, l’atmosphère. Malheureusement et heureusement, les inquiétudes face au climat et à la détérioration de notre atmosphère tendent à recevoir la plus forte attention médiatique. Des initiatives, sous l’instigation de la très jeune mais non moins inspirante Greta Thunberg (depuis sa grève scolaire pour le climat initiée en aout 2018), se sont multipliées à l’échelle internationale, provenant principalement de la société civile. Cela fait espérer un renouveau dans la prise de conscience globale sur la gravité de la situation, d’autant que la personnification de la lutte à travers la figure de Greta n’est pas forcément une mauvaise chose (encore que ce ne soit rien de nouveau sous le soleil). Je pense en particulier que le biais de la victime identifiable peut ici, pour une fois, être d’un grand secours pour frapper la conscience des gens : en effet, comme l’ont démontré notamment les travaux du psychologue américain Paul Slovic, nous avons tendance à attacher plus d’importance aux causes auxquelles on peut associer un visage connu, identifiable ou jugé proche qu’aux statistiques les plus rigoureuses sur l’urgence d’une situation. Cependant, je vais faire le pari (ma foi en l’humain m’y oblige) d’avancer quelques données et faits sur l’environnement, au lieu de me contenter de montrer un visage.
Ce vendredi 3 avril 2020, alors que près de trois milliards de personnes dans le monde se retrouvent confinés, plusieurs citoyens et citoyennes dans le monde, ayant réalisé que l’urgence climatique ne peut pas attendre, tout en reconnaissant l’importance d’« écouter la science » (pour reprendre la formule de Greta) en respectant les mesures prises par les autorités pour contrer la propagation du virus, se réunissent virtuellement pour manifester pour le climat. Je me retrouve parfaitement dans cette démarche et je crois qu’on a là un vrai problème, d’autant plus inquiétant qu’il échappe à l’instantanéité de la crise actuelle : il s’étale plutôt dans la durée et si on ne fait rien dans les meilleurs délais il risque d’être trop tard quand on voudra, contraint par les circonstances, rebrousser chemin.
Comme l’appel de Greta est à un #ClimateStrikeOnline, je veux bien y participer mais je veux également en profiter pour attirer l’attention non seulement sur le climat mais aussi sur l’état déplorable dans lequel se trouve l’ensemble de notre atmosphère actuellement. Car il n’y a pas que le climat, tout comme il n’y a pas que l’atmosphère dont l’état est préoccupant actuellement. Mais je veux bien me limiter à une présentation sommaire de la situation de notre chère atmosphère pour rester dans l’air du temps (sans jeu de mots).
Commençons par la pollution. C’est une bonne entrée compte tenu de l’actualité, car primo plusieurs études, certes controversées, évoquent une corrélation significative entre la concentration de particules fines (comme proxy de la pollution) et la vitesse de propagation du SARS-CoV-2 (le nom du virus responsable de la COVID-19). Deuxio, la COVID-19, en réduisant l’activité humaine dans les villes, est associée à une baisse frappante de la pollution dans certaines régions (mais qu’on ne se méprenne pas, le spectre des changements climatiques ou même d’un retour aux niveaux de pollution d’avant la COVID-19 reste présent).
La pollution de basse altitude fait référence à la présence, au-delà de ce qui est jugé acceptable, de substances nocives dans l’air que nous respirons. Elle implique un récepteur (l’être humain, en principe) et des symptômes. L’inhalation est le premier mode par lequel le polluant va pénétrer notre organisme, mais l’ingestion de produits contaminés directement ou indirectement (aliments, eau, etc.) est aussi possible. L’apparition de symptômes chez les individus dépend de plusieurs facteurs (concentration de la substance, prédisposition personnelle, exposition, etc.). Les principales substances responsables actuellement de la pollution de basse altitude sont les particules fines, l’ozone au sol (dont l’action ne doit pas être confondue avec celle, bénéfique, de l’ozonosphère), le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre. Les effets de la pollution ne doivent pas être minimisés. L’Organisation mondiale de la santé estime que la pollution de basse altitude (celle de l’air ambiant) cause en moyenne 4.2 millions de morts chaque année (sans compter les morts dus à d’autres formes de pollution de l’air).
Les limites fonctionnelles fixées pour la pollution de basse altitude reposent sur les concentrations de particules fines (qui peuvent affecter nos systèmes respiratoire et cardiovasculaire et résultent de la combustion de carburants fossiles ou autres mécanismes chimiques). Cela a l’avantage de décentrer l’attention sur les effets négatifs de la pollution de l’air sur la santé humaine. En effet, la présence des particules fines dans l’air a un lien avec le bilan énergétique de la planète qui, comme on le verra, est avec le réchauffement de la planète un des principaux indicateurs des changements climatiques.
En somme, la pollution de l’air n’est pas sans lien avec les changements climatiques et nous interpelle par le caractère immédiat de ses effets. Certes, aucun seuil universel de concentration de particules fines à ne pas dépasser n’est actuellement fixé, mais les effets délétères de la pollution de basse altitude n’en sont pas moins réels et certains pays semblent plus affectés que d’autres. Le fait que cela peut affecter notre santé pourrait être un argument assez fort pour qu’on prenne conscience de l’urgence climatique. Car, comme le montre un peu la crise sanitaire actuelle et la mobilisation mondiale extraordinaire pour trouver un remède et un vaccin rapidement, il semble malheureusement que tant que nous ne nous sentons pas directement concerné.e.s, les affaires du cabri ne sont pas celles du mouton.
L’autre limite fonctionnelle liée à l’atmosphère concerne précisément cette couche en haute altitude (au-delà de 10 km) appelée l’ozonosphère, composée à 90% d’ozone (on parle aussi de « couche d’ozone). Dans mon enfance (je suis né au début des années 90), c’était un grand sujet d’inquiétude. À l’école, on parlait souvent du « trou dans la couche d’ozone », une certaine peur régnait. Aujourd’hui, on n’en parle presque plus. Qu’est-ce qui a dû se passer?
D’abord, il faut comprendre que l’ozonosphère nous protège contre une partie du rayonnement solaire, les rayons ultraviolets, qui sont nocifs pour la santé (UVA, UVB, impliqués notamment dans certains cancers de la peau) ou empêcheraient même, dans le cas des UVC, la vie sur terre, sans le rôle de filtre que joue la couche d’ozone. Comment cela marche concrètement? Typiquement, l’énergie contenue dans les rayons ultraviolets du soleil contribue soit à dissocier les molécules d’oxygène (O2) en deux atomes qui vont à leur tour être impliqués dans la formation de l’ozone (O3), soit dans la dissociation des molécules d’ozone. On comprend donc que cela tourne en rond et qu’un certain équilibre s’établit. Et, de façon presque magique, ce mécanisme basique arrive à nous protéger des rayons nocifs du soleil.
L’unité utilisée pour décrire la concentration d’ozone atmosphérique, variable avec l’atmosphère et selon le point où l’on se trouve sur la planète, est l’unité Dobson (DU) qui décrit la quantité totale d’ozone dans une colonne d’air. Les problèmes ont commencé quand on s’est rendu compte à partir des années 80 d’une réduction importante de la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique. L’épaisseur avait été établie à seulement 100 DU au lieu des 300 DU environ trouvés en 1957, lorsque les mesures avaient commencé. Entre-temps il y avait eu l’émission massive de gaz issus des activités humaines, les chlorofluorocarbures (CFC), dont la contribution, entre autres facteurs, à la dissociation de l’ozone atmosphérique n’a été établie que plus tard. Quand on l’a réalisé, les dégâts étaient déjà importants, et on pouvait déjà parler de l’énorme « trou » dans la couche d’ozone au niveau de l’Antarctique.
Aujourd’hui, quand on regarde en arrière, la mobilisation internationale, notamment via le protocole de Montréal de 1987 et universellement ratifié en 2009, en vue de fermer ce trou dans la couche d’ozone a été extraordinaire et montre que quand on veut, on peut. Surtout si on s’y prend tôt. C’est l’une des rares bonnes nouvelles environnementales dont nous pouvons d’ailleurs nous vanter. De fait, d’une part le trou dans la couche d’ozone au niveau de l’Antarctique se referme progressivement (certes, pas seulement parce que nous avons réduit nos émissions de gaz nocifs pour la couche d’ozone). D’autre part, nous restons en-dessous de la limite fonctionnelle planétaire établie pour l’appauvrissement de la couche d’ozone, soit de 5% au maximum en tout lieu par rapport à la référence moyenne de la période 1964-1980. Même si on n’a pas encore retrouvé les niveaux d’avant 1980 et qu’il faut rester vigilant, la nouvelle est tout de même encourageante.
Nous en venons finalement à notre sujet du jour, les changements climatiques. Pour ne pas se perdre, retenons que deux limites fonctionnelles sont généralement identifiées : l’une relative au réchauffement de la planète et l’autre relative au bilan énergétique de la planète. L’effet de serre naturel est un phénomène sans lequel la température moyenne à la surface de la planète serait de -18 °C au lieu des 15 °C actuels. C’est le soleil qui réchauffe la terre. Ce n’est pas sorcier. Cela se fait principalement par l’énergie que contient son rayonnement infrarouge qui, avec les rayons ultraviolets mentionnés plus haut et la lumière visible, composent le rayonnement solaire qui nous parvient. La part de toute cette énergie qui arrive sur terre est captée puis libérée par le sol, les océans. La terre rayonne donc à son tour, principalement dans l’infrarouge. Cette énergie se perdrait dans l’espace sans l’effet de serre et la terre se refroidirait. Ici intervient un ensemble de gaz appelés gaz à effet de serre qui contribue à piéger cette énergie en l’empêchant de quitter atmosphère. C’est un processus parfaitement naturel et bénéfique pour la vie sur terre. Les problèmes commencent quand l’activité humaine s’est mise à accentuer de façon exagérée cet effet de serre.
Aujourd’hui, les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d’eau (60% de l’effet de serre total), le fameux gaz carbonique (35%) et l’ensemble (5% du total) formé du méthane, de l’ozone, de l’oxyde nitreux et même des CFC (de façon marginale) ou d’autres gaz encore. L’activité humaine a considérablement contribué à augmenter la concentration de certains gaz à effet de serre dans l’atmosphère et par ricochet la température de la planète (et le bilan énergétique sur lequel je reviendrai). L’homme libère ainsi du carbone atmosphérique notamment par la combustion de carburants, la production de ciment, la déforestation (les arbres des forêts constituant des sortes de puits de carbone). L’activité humaine a contribué également, par l’élevage industriel (celui des vaches est bien connu) et la production pétrolière à augmenter considérablement la concentration de méthane. Quant à l’oxyde nitreux, c’est surtout la production d’engrais agricoles qui a contribué à son augmentation.
L’analyse de l’évolution des températures montre que la température moyenne de la terre a connu une augmentation de 0,85 °C entre 1800 et 2012. La limite fonctionnelle est généralement définie à partir de la concentration de gaz carbonique dans l’atmosphère. Cette concentration était d’environ 280 parties par million dans l’ère préindustrielle (avant 1750), les chercheurs ont calculé qu’elle ne devrait pas dépasser 350 parties par million si on veut respecter les limites de la planète. Or, mauvaise nouvelle, en 2012 elle était déjà à 392 parties par million! Pourtant, les valeurs calculées en 1959 montrent qu’à cette époque on était encore en-dessous des limites, la situation s’est donc vraiment détériorée dans les dernières décennies et ne cesse de se détériorer.
Aujourd’hui, même si beaucoup de pays se sont fixés un objectif global de garder l’augmentation de la température moyenne de la terre en -dessous de 2 °C notamment par la réduction de leur émission de gaz à effet de serre, la principale inquiétude est qu’on ne franchisse prochainement un point de non-retour compte tenu du rythme auquel cela évolue et de la négligence de plusieurs pays au vu de l’urgence climatique. Si la concentration de gaz carbonique venait à doubler par rapport aux concentrations préindustrielles, on estime que la température globale pourrait augmenter de 1,5 à 4,5 °C. Un tiers de cette augmentation de température serait du à l’effet direct de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, le reste à des effets indirects (fonte des glaciers, boucle de rétroaction passant par l’augmentation de la concentration de la vapeur d’eau, etc.).
On a aussi parlé du bilan énergétique. L’augmentation anthropique de la concentration des gaz à effet de serre affecte le bilan énergétique de la terre. Ce bilan renvoie à un équilibre entre énergie captée par la terre et énergie émise. L’effet de serre anthropique, en piégeant encore plus l’énergie infrarouge émise par la terre, réchauffe non seulement la planète mais bouleverse également l’équilibre entre l’énergie solaire qui entre et l’énergie émise par la terre. On parle de forçage radiatif, renvoyant à ce décalage qui se mesure en watts par mètre carré à la surface de la terre. La limite fonctionnelle établie impose de ne pas dépasser un excédent de 1 watt par mètre carré. Les mesures nettes du bilan énergétique font état malgré tout d’un excédent de 2,3 watts par mètre carré, soit beaucoup plus que la limite fonctionnelle indiquant le maximum à ne pas dépasser.
Tous ces bouleversements, qui ne sont en réalité pas isolés de ceux que subissent la biosphère et l’hydrosphère, montrent l’urgence de la situation actuelle. On vit à crédit. Un crédit qui, à mesure que le temps passe, risque de devenir trop lourd. Nous courrons littéralement vers la faillite planétaire. Cette image doit être efficace, puisque nous ne jurons plus que par l’économie, même en temps de crise sanitaire : la COVID-19 l’a bien démontré. Même si, comme discuté dans ce billet, tout n’est pas noir (qu’on pense à l’ozonosphère, entre autres domaines où l’on garde une marge de manœuvre), cela risque de ne plus avoir d’importance si les excès n’arrêtent pas. Cela montre toute la prégnance de l’urgence climatique.
Comme mentionné dès le début, les problèmes environnementaux ne se résument pas à la question climatique. Certes. Mais la question climatique est indéniablement l’un des défis les plus urgents à relever et reste intimement lié à tous les autres aspects de notre vie actuelle et de « notre avenir à tous » (et à toutes), pour reprendre le nom de ce fameux rapport Brundtland qui en 1987 avait marqué une prise de conscience planétaire de la nécessité d’un changement d’approche. Un changement d’approche, c’est ce qu’il faut, et non d’un « pause sanitaire ». Plus de 30 ans après le rapport Brundtland, les choses ont malheureusement très peu bougé, si on ne compte pas les promesses non honorées et les faux engagements. Il est temps que cela bouge. Vraiment. Et ces débats doivent continuer, voire même s’intensifier pendant et après la COVID-19. Parce que, exactement comme face à cette pandémie qui aurait pu être évitée, on a encore le choix, mais le temps est compté. Si le souhait est qu’on trouve un remède et un vaccin le plus vite possible, on doit lutter pour qu’à ce sentiment d’urgence sanitaire succède celui de l’urgence climatique, autrement plus menaçante. Il s’agit tout simplement de garantir notre avenir à tous et à toutes.