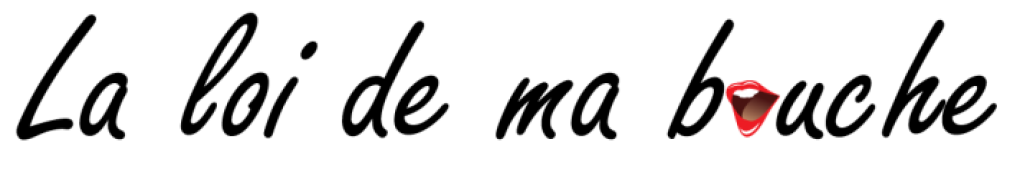Les examens du bac arrivent et j’en ai reçu ce spécimen d’un lecteur assidu du blog avec pour instruction de répondre oui au sujet 2. Je vais donc me prêter au jeu, comme si j’étais encore bachelière.
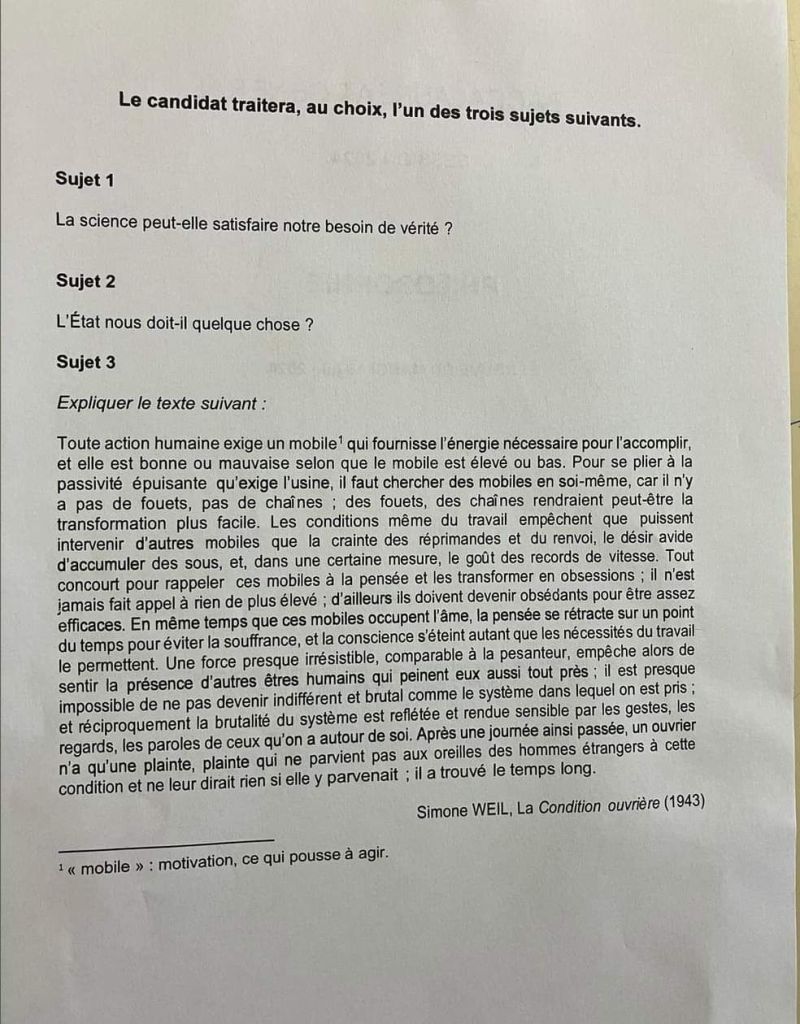
L’État nous doit-il quelque chose ?
Introduction
L’interrogation quant aux obligations de l’État envers ses administrés est une constante dans la théorie politique. Elle se décline généralement en termes de garanties de la sécurité, des droits fondamentaux, et des services publics essentiels aux citoyens. Des garanties en échange desquels nous offrons notre respect des lois et de nos devoirs envers la société. Toutefois, sans les individus qui composent la société et qui consentent à former un État, celui-ci n’aurait pas de légitimité ni de pouvoir.
L’État nous doit tout puisqu’il nous doit son existence. Depuis les penseurs classiques tels que Hobbes, Locke, et Rousseau jusqu’aux contemporains comme Tilly, la question de savoir si l’État doit quelque chose à ceux qu’il gouverne trouve sa réponse dans la nature même de sa création et de sa légitimité. Cette dissertation explorera cette dynamique complexe à travers l’analyse des théories du contrat social, de la souveraineté populaire, et des obligations réciproques entre l’État et les individus.
L’État est né consentement et du contrat social
Selon les théories du contrat social, initiées par Thomas Hobbes et développées par John Locke, l’État naît d’un accord implicite entre les individus d’une société. Hobbes envisage cet accord comme une réponse à l’état de nature, où la vie serait « solitaire, pauvre et courte ». Ainsi, les individus consentent à céder une partie de leurs libertés naturelles en échange de la sécurité et de l’ordre garantis par l’État. Locke, de son côté, ajoute que cet accord implique également la protection des droits naturels à la vie, à la liberté, et à la propriété. En ce sens, l’État ne doit pas seulement son existence à ce consentement initial, mais il est également obligé de respecter et de protéger les droits fondamentaux de ses citoyens.
Dans notre pays, par exemple, l’absence d’un pouvoir central fort et légitime a souvent mené à des périodes d’instabilité et de conflits violents. En consentant à la formation d’un État, Les citoyens haïtiens sont en droit d’attendre un État capable de garantir la sécurité et de maintenir l’ordre public. En échange de cette sécurité, ils ont accepté de céder une partie de leurs libertés naturelles, tel que leur droit de se faire justice eux-mêmes, pour permettre à l’État de monopoliser la violence légitime et d’assurer la sécurité collective. La mainmise des gangs sur la capitale et l’augmentation des instances de bwa kale sont des indicateurs d’un échec de l’État haïtien à accomplir son rôle et conséquemment son incapacité à faire respecter ses lois.
L’État doit sa légitimité à la souveraineté populaire
Une autre perspective fondamentale est celle de la souveraineté populaire, développée par Jean-Jacques Rousseau. Selon Rousseau, le pouvoir politique émane directement du peuple, et non d’une quelconque autorité divine ou héréditaire. Ainsi, l’État tire sa légitimité du consentement actif et continu des individus qui composent la société. Cette conception renforce l’idée que l’État existe en vertu de la volonté des citoyens, et donc il a l’obligation de gouverner dans l’intérêt général et de répondre aux attentes légitimes de ceux qu’il représente.
Pendant la Révolution française, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 a été rédigée sur la base des idées de souveraineté populaire. Les révolutionnaires ont rejeté l’autorité absolue du roi et ont affirmé que le pouvoir politique émanait directement du peuple français. Cette affirmation a servi de fondement pour établir un État républicain où les droits individuels et collectifs étaient protégés et où le gouvernement était responsable devant les citoyens, répondant ainsi aux attentes légitimes de la société.
L’État et les individus ont des obligations réciproques
En contrepartie de l’acceptation de son autorité, l’État assume des responsabilités envers ses citoyens. Ces obligations incluent la protection contre les menaces internes et externes, l’assurance de conditions de vie décentes et l’accès aux services publics essentiels. Charles Tilly, par exemple, théorise que l’État monopolise la violence légitime pour garantir l’ordre et la sécurité. Ainsi, les citoyens fournissent leur consentement à l’État en échange de ces services et protections essentiels à leur bien-être.
Aux États-Unis, la responsabilité de l’État de protéger contre les menaces internes et externes est clairement illustrée par ses efforts continus en matière de sécurité nationale. Des agences comme le FBI, la CIA et le département de la Défense sont chargées de prévenir les attaques terroristes, de maintenir l’ordre public et de défendre le pays contre les adversaires étrangers. Les citoyens américains soutiennent ces mesures de sécurité nationale en échange de la protection de leurs vies et de leurs droits.
Conclusion
En conclusion, l’État ne peut être compris indépendamment de ceux qu’il gouverne. Son existence découle du consentement et de l’acceptation de ses citoyens, ce qui implique des obligations significatives envers ces derniers. Ces obligations vont au-delà de la simple reconnaissance de l’autorité de l’État ; elles englobent la protection des droits fondamentaux, la garantie de conditions de vie décentes, et la provision de services publics indispensables. En ce sens, l’État doit quelque chose à ses citoyens non seulement en termes de sécurité et de protection, mais aussi en termes de respect de leur dignité et de leurs aspirations collectives.
Ainsi, la relation entre l’État et ses citoyens est une relation de réciprocité où chacun doit à l’autre une part de responsabilité et de reconnaissance. Cette dynamique complexe illustre la manière dont l’État, en tant qu’institution sociale et politique, est fondamentalement redevable à ceux qu’il représente et qu’il gouverne.